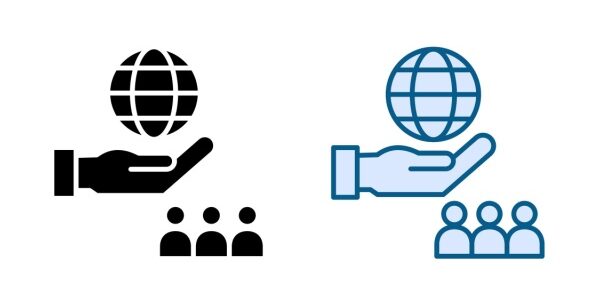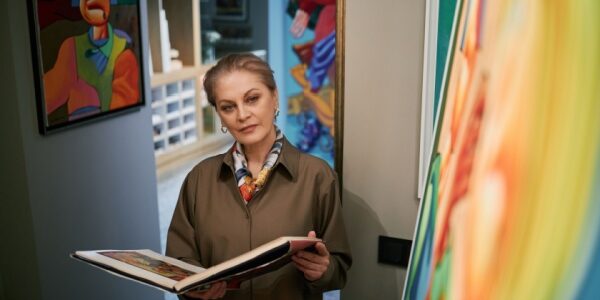Plusieurs mesures propres au secteur de l’économie sociale et solidaire méritent d’être signalées, issues de la loi de finances pour 2026, et qui visent notamment les réductions d’impôt sur le revenu propres aux investissements dans les entreprises solidaires d’utilité sociale, les dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté, la taxe d’apprentissage et l’expérimentation « Territoire 0 chômeur », etc.
Réductions et crédits d’impôt sur le revenu
Pour les entreprises solidaires d’utilité sociale
Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin » ou « IR-PME ».
Les entreprises solidaires d’utilité sociale s’entendent des entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui :
- soit emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;
- soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissent certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % dernièrement pour les versements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025.
La loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 au titre des souscriptions réalisées en numéraire au capital des entreprises d’utilité sociale est fixé à 25 %.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2026, sauf pour les versements effectués à compter du 1er octobre 2026 pour lesquels l’application du taux de 25 % s’appliquera à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de 2 mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition qui lui a été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Pour les sociétés foncières solidaires
Pour rappel, les particuliers domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 %, majoré à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025, des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés foncières solidaires, au même titre que les entreprises solidaires d’utilité sociale.
Entre autres conditions, le particulier doit s’engager à conserver les titres jusqu’au 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription. Notez qu’en cas de non-respect de la condition de conservation, l’avantage est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse de respecter cette condition.
Les apports ne peuvent en outre pas être remboursés au souscripteur avant le 31 décembre de la 7e année suivant celle de la souscription, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise.
La loi de finances pour 2026 aligne les délais de conservation des titres et de remboursement des apports, en les fixant tous les deux à 5 ans, pour les sociétés foncières solidaires.
Les apports ne pourront ainsi pas être remboursés avant le 31 décembre de la 5e année suivant celle de la souscription (contre 7e année auparavant).
Cette nouvelle mesure s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2026 a prolongé cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027 tout en précisant que le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2027 est fixé à 25 %.
Dons aux associations d’aide aux personnes en difficulté
Les particuliers qui effectuent des dons au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins à des personnes en difficulté, ainsi qu’au profit d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violence domestique, ou contribuent à favoriser leur relogement, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 75 % des versements effectués, retenus dans la limite de 1 000 € depuis l’imposition des revenus de l’année 2024.
Si la loi de finances pour 2025 a pérennisé le plafond exceptionnel de 1 000 €, la loi de finances pour 2026, quant à elle, double cette limite de 1 000 € pour la porter à 2 000 € pour les dons et versements effectués à compter du 14 octobre 2025.
Crédit d’impôt au titre des services à la personne
Un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses, retenues dans certaines limites, engagées bénéficie aux contribuables employant un salarié à leur domicile. Pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne, le bénéficiaire doit :
- soit être employeur direct d’un salarié intervenant à son domicile (via la signature d’un contrat comme le CDD ou le CDI ou via le CESU) ;
- soit employer une association, une entreprise ou un organisme déclaré proposant des services à la personne, ou un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, pour que des travaux soient faits à son domicile.
Les dépenses prises en compte pour le calcul de l’avantage fiscal doivent concerner des travaux exécutés dans la résidence principale ou secondaire du bénéficiaire ou au domicile d’un ascendant, à la condition que celui-ci remplisse les conditions pour bénéficier de l’aide aux personnes âgées (APA).
Depuis l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ du crédit d’impôt englobe également des prestations réalisées à l’extérieur de la résidence, lorsqu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à résidence (« offre globale »).
La loi de finances pour 2026 précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence doit s’entendre de services fournis au contribuable par un même salarié, une même association, une même entreprise ou un même organisme.
Par ailleurs, les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.
Enfin, pour les personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, la loi de finances pour 2026 assimile la livraison de repas à domicile à un service fourni à la résidence du contribuable afin de la rendre éligible, par nature, au crédit d’impôt services à la personne, y compris si elle n’est pas comprise dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.
Taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage est une contribution due par certains employeurs. Elle participe au financement de l’apprentissage, ainsi que des formations technologiques et professionnelles.
Calculée sur la base des rémunérations versées aux salariés, cette taxe est due par les entreprises individuelles, les sociétés et les groupements d’intérêt économique qui exercent une activité commerciale, artisanale ou industrielle.
Jusqu’à présent, en étaient exonérés les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats exerçant une activité non lucrative. La loi de finances pour 2026 met fin à cette exonération.
Par conséquent, ces structures non lucratives devraient prochainement être assujetties à la taxe d’apprentissage.
À ce stade, la loi de finances pour 2026 ne précise pas la date d’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.
En l’absence de disposition spécifique, et par principe, la taxe sera donc due à compter du 21 février 2026.
Notez toutefois que, comme cela avait déjà été le cas lors de la suppression de l’exonération dont bénéficiaient les organismes mutualistes (assujettis depuis février 2025), l’administration sociale pourrait, par tolérance, repousser l’application effective de la taxe au 1er jour du mois suivant la publication de la loi, soit au 1er mars 2026.
Dispositif « Territoire 0 chômeur »
L’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » a été lancée par la loi d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée.
Elle vise à créer des emplois en CDI pour des personnes privées d’emploi depuis plus d’un an, via des structures de l’économie sociale et solidaire appelées « entreprises à but d’emploi ».
L’idée est de financer ces emplois en utilisant une partie des dépenses « évitées » grâce au retour à l’emploi (moins d’allocations chômage, plus d’impôts et de cotisations).
Une première phase a démarré en 2016 avec 10 territoires, puis une deuxième phase a été ouverte par la loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée », ce qui a permis d’habiliter 73 territoires supplémentaires.
Initialement, cette seconde phase était censée s’achever le 30 juin 2026.
La loi de finances pour 2026 proroge cette expérimentation pour une durée de 6 mois supplémentaires, aux mêmes conditions. Ainsi, l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » s’achèvera le 31 décembre 2026 et non le 30 juin 2026 comme prévu initialement.
Secteur de l’économie sociale et solidaire : du nouveau en 2026 – © Copyright WebLex